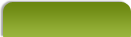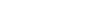Naguib Mahfouz, le peuple et la civilisation égyptienne |

|
Titre de la collection
Le cercle de minuit
Date de première diffusion
03/02/1997
Résumé
Extrait de l'émission '' Le cercle de Minuit ". Chez lui au Caire, interviewé par Laure Adler, l'écrivain Naguib Mahfouz donne sa définition du peuple égyptien : un esprit malicieux et plein d'humour ; il répond à L. Adler sur l'attractivité qu'exercent l'histoire et la civilisation égyptienne sur les Occidentaux.
Chaîne de première diffusion
FTV - F2
Forme audiovisuelle
Entretien
Thème principal
Langues et littératures
Thème secondaire
- Héritages historiques / Antiquités
- Héritages historiques / Mondes arabe et musulman
Générique
- Adler Laure - Journaliste
Lieux
- Egypte - Basse Egypte - Le Caire
Contexte
Naguib Mahfouz, le peuple et la civilisation égyptienne
Richard Jacquemond
Depuis 1988 et le prix Nobel de littérature qui lui a été attribué (voir contexte de l’archive « Naguib Mahfouz » - ERU00276) et jusqu’à son décès en 2006, à l’âge de 94 ans, Naguib Mahfouz aura été, aux yeux de millions de lecteurs arabes et étrangers, l’incarnation d’une Egypte éternelle dont les valeurs cardinales seraient humour et civilité, modération et tolérance, enracinement dans l’histoire et universalité du message qu’elle porte aux autres cultures et nations. Dans cette interview pour la télévision française en 1997, le grand écrivain revêt d’autant plus aisément cet habit d’ambassadeur de l’Egypte éternelle, « mère du monde » (oumm ed-donya), comme elle-même aime à s’appeler, que les questions de Laure Adler semblent faites pour susciter ces réponses en forme de vérités immuables et consensuelles.
Contrepoint : dans les années 1990, cette image d’Epinal est pourtant sérieusement écornée par la confrontation violente entre le régime et la frange la plus radicale de l’opposition islamiste : 1997 est aussi l’année de l’attentat le plus meurtrier exécuté par cette dernière (62 touristes assassinés près du temple d’Hatchepsout à Louxor le 17 novembre). Mahfouz a lui-même été victime, trois ans plus tôt (14 octobre 1994), d’une tentative d’assassinat à l’arme blanche, perpétrée par deux jeunes Egyptiens qui croyaient ainsi exécuter une fatwa du cheikh Omar Abdel-Rahman, le maître spirituel de la Gamaa islamiyya, le groupe islamiste radical égyptien le plus actif : en 1989, à la suite de la fatwa de l’ayatollah Khomeiny appelant chaque musulman à tuer Salman Rushdie, l’auteur des Versets sataniques, Abdel-Rahman (qui purge depuis 1995 une peine de prison à vie aux Etats-Unis) avait déclaré : « Rushdie doit être tué, et si Naguib Mahfouz avait subi le même traitement lorsqu’il a écrit Les fils de la médina [1959], cela aurait servi de leçon à Salman Rushdie et à quiconque parle en mal de l’islam ».
L’échange aimable entre Laure Adler et Naguib Mahfouz culmine avec l’évocation de l’égyptomanie française, trait le plus saillant du lien particulier qui lierait l’Egypte à la France. Partie pour coloniser l’Egypte en barrant la route des Indes aux Anglais (campagne de Bonaparte en Egypte, 1798-1801), principale créancière du pays après la construction du Canal de Suez (inauguré en présence de Napoléon III en 1869), la France est « doublée » par l’Angleterre qui occupe l’Egypte à partir de 1882. Elle conserve néanmoins durant cette période d’occupation (1882-1952) des positions fortes, et notamment le contrôle des Antiquités égyptiennes – d’où la forte tradition égyptologique française. Sous l’occupation britannique, les élites égyptiennes joueront souvent la France pour contrer la perfide Albion, d’où une certaine complicité égypto-française dont on perçoit l’écho dans la réponse de Mahfouz.
L’idée d’une continuité à travers l’histoire du peuple égyptien, survivant à une longue série d’invasions au fil des siècles (« d’Alexandre à Napoléon », dit L. Adler), changeant de langue et de religion sans perdre son identité de base liée à l’occupation millénaire de vallée du Nil (N. Mahfouz), cette idée est, en dépit de son caractère d’évidence pour nous aujourd’hui, une idée profondément moderne : elle est le fruit de la construction bicentenaire du nationalisme égyptien, un nationalisme dont Naguib Mahfouz aura été, au fil de son œuvre romanesque, l’un de ceux qui l’ont représenté et élaboré avec le plus de constance, et de finesse.
Bibliographie :
Florence Quentin (dir.), Le livre des Egyptes, savoirs et imaginaires, Paris, Robert Laffont (coll. Bouquins), 2012