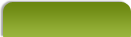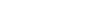Les fadas du pointu |

|
Titre de la collection
Thalassa : le magazine de la mer
Date de première diffusion
04/03/2005
Résumé
Portraits de quelques passionnés du "pointu" ce petit bateau de pêche à voile latine qui avait presque disparu de Méditerranée ; Rencontre avec Patrick Girard, charpentier de marine, avec Laurent Da Monte, un vieux Marseillais qui a relancé ce type de bateau et du propriétaire d'un pointu moderne, avec coque en plastique...
Tartanes, moure de pouare, barquette ou barque catalane... De Port Vendres à Menton, les pointus (c'est leur nom générique) sont le symbole de la voile latine en Méditerranée.
Sociétés de production
-
France 3 - Production propre
Chaîne de première diffusion
FTV - F3
Forme audiovisuelle
Magazine
Thème principal
Pêche et activités portuaires
Thème secondaire
- Economie / Marchés et artisanat
Générique
- Edel Bertrand - Journaliste
Lieux
- France - Sud Est - Saint Tropez
Langue d'origine
Français
Contexte
Les fadas du pointu
Céline Regnard
Sous le terme « pointu » on désigne depuis près de 150 ans une multitude de bateaux de pêche utilisés depuis 4000 ans en Méditerranée. L’appellation « pointu » n’a, en effet, rien de provençal. Elle aurait été utilisée pour la première fois à Toulon par les hommes de la Marine nationale, qui, pour distinguer leurs propres bateaux, plats de l’arrière, des esquifs locaux, les auraient ainsi désignés par la forme caractéristique de leur avant et de leur arrière. Le mot aurait ensuite été relayé par Jules Vence dans son ouvrage Construction et manœuvre des bateaux et embarcations à voilure latine, pêche-batelage-pilotage-plaisance, publié en 1897. Ce terme générique désigne donc en réalité une grande variété de petites embarcations à rames, parfois dotées de voiles latines, telles que les « rafiau » (ainsi désignés par des marins bretons en raison de leur forme peu élégante), « gourses », « barquettes » mais aussi le fameux « mourre de pouar » (dont l’éperon évoque le « groin de porc » en provençal), le « bateau-pilotte » ou la bette.
Leur forme est adaptée aux conditions de navigation en Méditerranée, où les tempêtes sont violentes et soudaines, et, pour ce qui est de la côte française, où le Mistral est le vent dominant et génère une mer courte et creuse. Robuste, les pointus, se comportent donc bien que la mer vienne de l’avant ou de l’arrière. Adaptés à la pêche au trémail (filet calé au fond), ils appartiennent à la même famille de bateaux que les galères, ou les tartanes. Ce type de bateau, dont la longueur habituelle est de 6 mètres, bien qu’il existe des pointus de 8 mètres, est construit dans toute la Méditerranée, mais présente des variantes locales, héritages des traditions des charpentiers de marines venus de Catalogne, de Ligurie, de Naples ou de Sicile. Sa fabrication repose sur l’utilisation d’essences de bois locales, utilisées de façons variables selon leurs qualités. Le pointu est gréé en voile latine, d’influence arabe. Le mat autoporteur fait la longueur du bateau, l’antenne est un peu plus longue, de sorte que la voile couvre plus de 20 mètres carrés. Les pêcheurs utilisaient la voile et la rame pour se rendre du port au lieu de pêche et pour en revenir. La motorisation des pointus s’est généralisée à partir des années 1920. Le pointu, bateau de pêche, est donc façonné et utilisé depuis des générations, lorsqu’il connaît un âge d’or entre 1850 et 1930 en raison du remplacement de la voile par le moteur et de l’essor de l’industrie de la pêche. En 1926 dans le Var, 1600 marins pêcheurs naviguent sur 663 pointus. Les captures sont alors très importantes : cette année là les ports de Toulon et La Seyne voient débarquer plus de 22 tonnes de poissons. À la même époque les pointus, armés par des pêcheurs ou des plaisanciers, s’affrontent dans des régates. La plus connue est celle de la rade de Toulon organisée par les associations nautiques de Toulon et de La Seyne. La pêche est, en Provence, un reflet de l’ouverture de la terre et de la mer aux peuples venus d’ailleurs. Les pêcheurs italiens, qui venaient nombreux à proximité des côtes provençales depuis le XVIIIe siècle, font progressivement souche dans les petits ports côtiers, et ce d’autant plus qu’une loi de 1888 réserve la pêche côtière aux Français.
À Marseille les métiers de la mer sont très largement ceux des « Napolitains », venus pour beaucoup d’entre eux du Sud de l’Italie, qui vivent dans le quartier du Panier. Au lendemain des décolonisations algériennes et tunisiennes, de nombreux patrons pêcheurs, souvent Pieds-Noirs, s’installent en Provence. Comme la pêche côtière, le pointu a progressivement périclité au cours de la seconde moitié du XXe siècle, jusqu’à disparaître presque totalement. C’est aujourd’hui sous la forme d’un patrimoine méditerranéen et populaire qu’il renaît, grâce à des associations qui réhabilitent d’anciens bateaux. En 2005, on en compterait 10 000 de Port-Vendres à Menton, dont 200 équipés d’une voile latine. Les amateurs et passionnés se rencontrent depuis 2000 à Saint-Tropez lors de la compétition Les voiles latines, régate internationale qui voit s’affronter des pointus dans le golfe.
Bibliographie :
Daniel Faget, Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIIIe - XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011
Pierre Blasi et André Daries, Et voguent barquettes et pointus, Aix-en-Provence, Edisud, 1999
« Le pointu », Les carnets du patrimoine n°4, 2007, Conseil Général du Var